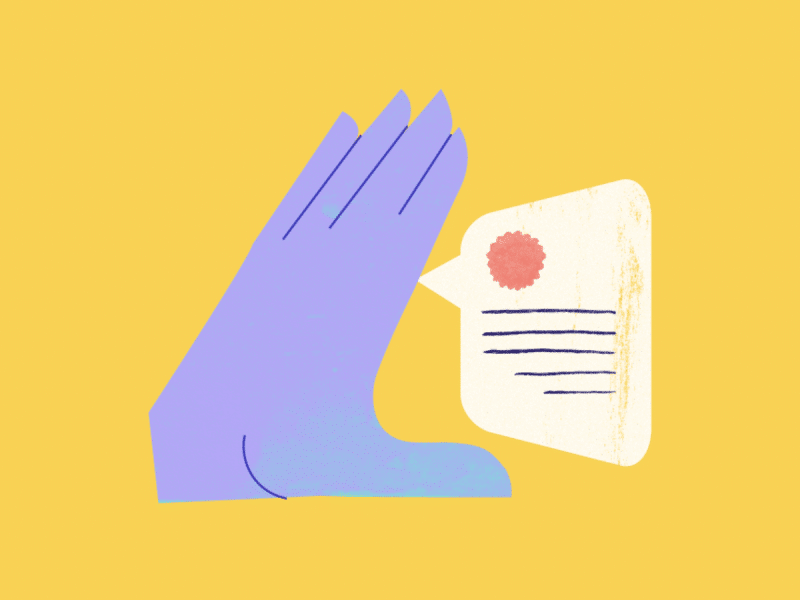Ce mardi soir aura lieu le troisième dénombrement de l’itinérance visible partout au Québec. À Montréal, ce sont 1200 bénévoles qui sillonneront les rues pour réaliser cet exercice d’envergure qui « bien qu’imparfait, reste encore le meilleur moyen d’obtenir un portrait fiable de l’itinérance dans la métropole ».
Ça, c’est le pitch de vente des représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux qui mène depuis plusieurs semaines une imposante campagne de communication reliée au dénombrement. La lecture communautaire, elle, est beaucoup plus critique.
Lors des dénombrements de 2014 et de 2018, le Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) et ses membres ont levé les drapeaux rouges sur les nombreuses failles que soulève le dénombrement en tant qu’exercice pour comprendre le phénomène de l’itinérance visible. En effet, le dénombrement est un polaroid incomplet, une photo d’un soir donné, qui ne permet pas de saisir ni la diversité des réalités ni l’ampleur du phénomène.
Mais il n’y a pas que ça. Au-delà des lacunes méthodologiques, il y a tout le caractère violent du dénombrement, d’un point de vue des droits de la personne, dont on parle peu.
Une méthode violente
Ce n’est pas anodin si on compte les personnes en situation d’itinérance VISIBLE. Celles qui dérangent. Celles que personne ne veut nulle part, ni dehors, ni en dedans.
On ne les veut pas dans les parcs ni dans les rues de notre quartier, on ne les tolère pas dans une tente, on ne les tolère pas non plus dans les entrées de commerces ou les édicules de métro. Même le Réseau de la santé compte plus de portes de sortie pour elles que de portes d’entrée.
On les déplace, on les judiciarise, on les démantèle, on les laisse mourir de froid ou de surdose. Où ont-elles leur place? Dans un logement? Lequel? En voulant éliminer l’itinérance visible, on est de facto violent envers les humains qui la vivent.
Si le dénombrement est violent d’un point de vue des droits de la personne, il l’est aussi d’un point de vue de dignité humaine. Au-delà du décompte, les bénévoles à peine formés poseront toute une série de questions intrusives aux personnes avec qui elles n’ont aucun lien de confiance. On vient ainsi intervenir dans les traumas de vie des gens, sans être en mesure d’apporter un soutien, si ce n’est qu’à travers une carte cadeau pour du café et des beignes.
Un show de boucane
Il est vrai qu’on ne connaît pas tout de l’itinérance. Nos membres témoignent encore d’une négation du phénomène dans plusieurs arrondissements plus éloignés du centre-ville. Beaucoup de chemin reste à faire pour répondre adéquatement aux besoins des jeunes, des femmes, dont les femmes trans, des personnes autochtones en situation d’itinérance.
Mais le dénombrement de l’itinérance visible est incapable de documenter ces réalités.
Comment se fait-il qu’un tel exercice, biaisé d’un point de vue scientifique, limité méthodologiquement et problématique sur le plan éthique, continue d’être celui qui est privilégié par nos gouvernements, alors que les organismes qu’ils financent leur fournissent de manière fréquente des statistiques, des données qualitatives et quantitatives pourtant révélatrices des constats et des besoins du terrain?
C’est à croire qu’on ne s’y intéresse pas vraiment, qu’on ne cherche pas à s’attaquer aux causes profondes et aux solutions réelles de l’itinérance. On préfère le show de boucane du dénombrement, qui mobilise énormément de personnes et d’argent, et ainsi avoir l’air de faire quelque chose.
Des solutions connues
Dans les faits, depuis le résultat du dénombrement de 2018, qui pointait déjà vers une hausse de l’itinérance visible, qu’est-ce que nos gouvernements on fait de concret et de durable en matière d’investissement en prévention et en réduction de l’itinérance?
Certes, les fonds d’urgence descendus dans le contexte de la crise sanitaire nous ont permis d’agir, en patchant des trous de notre filet social mal en point. De très grosses sommes d’argent, qu’il fallait décaisser rapidement et qui ont surtout servi à financer des hôtels et des sous-sols d’églises mal chauffés pour l’ouverture de sites d’urgence à gros volume, opérés principalement par des agents de sécurité.
Si on doit poursuivre nos efforts pour mieux comprendre le phénomène de l’itinérance, on connaît depuis longtemps les solutions : assurer un revenu décent, financer le logement social et communautaire, offrir des soins de santé adaptés, exempts de stigmatisation et de discrimination, augmenter de manière significative le financement à la mission des groupes communautaires, etc.
Le phénomène est complexe et comme société, on devrait se questionner sur ce qu’on est réellement prêt à faire en matière de prévention de l’itinérance et d’amélioration des conditions de vie de toutes et tous.
Annie Savage est directrice du Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM).